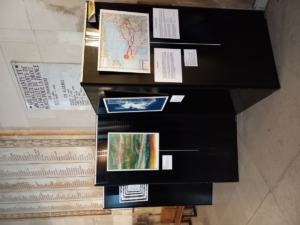Réparation symbolique d’un sentiment d’injustice
Par Nathalie Dion
DEFINITION :
La contrainte consiste à proposer un exemple de réparation symbolique d’un sentiment d’injustice. Du grec sumbolon, le symbole est un « signe figuratif, un être animé ou une chose qui représente une chose abstraite » ; la balance est ainsi le symbole de la justice (Dictionnaire Larousse, v° Symbole).
APPLICATION :
Les deux propositions suivantes mobilisent un acte symbolique prenant appui sur la commune intention des deux protagonistes : la victime et l’auteur de l’injustice.
Proposition 1 : réparation symbolique d’une surdité occasionnée par des coups et blessures
Cas réel : La demande de la victime, lycéenne, à l’égard de l’auteur de l’infraction est la suivante : « Je souhaiterais que tu saches ce que c’est que d’être sourd… ». Elle entend sensibiliser l’auteur aux conséquences de son comportement. L’auteur de l’infraction accepte (apparemment dans le cadre d’une médiation pénale) qu’une rencontre ait lieu dans une école pour jeunes malentendants de suivre des cours avec ceux-ci et de s’entretenir avec le personnel médical de l’établissement (Médiations et Sociétés, 2003, n° 4, p. 16).
Proposition 2. Réparation symbolique d’une violence domestique. Cas fictif : Un père punit un jour sa fille, alors enfant, en lui donnant 4 gifles (pour une simple « bêtise » que celle-ci avait faite). A 17 ans, sa fille lui en voulant toujours, le père accepte que, lors d’une cérémonie familiale, celle-ci le gifle « publiquement » (et lui « rende » ainsi les gifles données).
COMMENTAIRE :
Le Processus de réparation symbolique consisterait, par exemple, à reconnaître sa part (même si « on ne l’a pas fait exprès ») dans le conflit, à s’excuser (« je suis allé(e) trop loin », « je suis désolé(e)») pour apaiser la relation, à poser un acte (lettre remise en mains propre ou postée, discussion orale face à face ou au téléphone, ou acte plus impliquant). Précisons que la réparation symbolique n’exige pas d’apprécier l’autre, de se réconcilier ; elle peut être suivie du choix de s’écarter de l’autre, de renoncer à le fréquenter à nouveau ou à lui parler.
La réparation symbolique est possiblement porteuse :
- d’horizontalité (les deux protagonistes devenus acteurs du processus de réparation, y collaborent ensemble),
- d’un temps d’écoute substantiel,
- d’une approche potentiellement globale (juridique et psychologique, affective, émotionnelle, culturelle, transgénérationnelle, etc.) du différend,
- d’un acte pensé et posé par les protagonistes et qu’ils perçoivent comme « juste » pour chacun. Un acte suffisamment chargé de sens pour agir sur le conscient et l’inconscient (si l’on considère que l’inconscient donne au symbole la même importance qu’aux faits réels).
On peut imaginer que cet acte soit prolongé par un objet : un symbole universel de paix (colombe) ou un symbole plus personnel choisi par les intéressés (statuette).
Cette réparation symbolique est possiblement :
– transformatrice entraînant un processus de pacification, non pas seulement formel, mais véritable,
– thérapeutique (vectrice d’une guérison de la relation).
La réparation symbolique serait-elle amenée à devenir, un complément de la démarche judiciaire, du procès ?